Accueil > 03 - HISTORY - HISTOIRE > 3ème chapitre : Révolutions bourgeoises et populaires > L’histoire de la conquête du Brésil par les Occidentaux, racontée par (...)
L’histoire de la conquête du Brésil par les Occidentaux, racontée par Lévi-Strauss
jeudi 10 octobre 2019, par

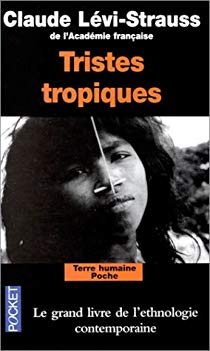
L’histoire de la conquête du Brésil par les Occidentaux, racontée par Lévi-Strauss
« J’avais été l’élève de Georges Dumas à l’époque du « traité de psychologie »… J’ai toujours regretté de ne pas l’avoir connu en pleine jeunesse, quand, brun et basané à l’image d’un conquistador et tout frémissant des perspectives scientifiques qu’ouvrait la psychologie du XIXe siècle, il était parti à la conquête spirituelle du Nouveau Monde. Dans cette espèce de coup de foudre qui allait se produire entre lui et la société brésilienne s’est certainement manifesté un phénomène mystérieux, quand deux fragments d’une Europe vieille de quatre cents ans – dont certains éléments essentiels s’étaient conservés, d’une part dans une famille protestante méridionale, de l’autre, dans une bourgeoisie très raffinée et un peu décadente, vivant au ralenti sous les tropiques – se sont rencontrés , reconnus et presque ressoudés.
L’erreur de Georges Dumas est de n’avoir jamais pris conscience du caractère véritablement archéologique de cette conjoncture. Le seul Brésil qu’il avait su séduire (et auquel un bref passage au pouvoir allait donner l’illusion d’être le vrai), c’était celui de ces propriétaires fonciers déplaçant progressivement leurs capitaux vers des investissements industriels à participation étrangère, et qui cherchaient une couverture idéologique dans un parlementarisme de bonne compagnie, ceux-là mêmes que nos étudiants, issus d’immigrants récents ou de hobereaux liés à la terre et ruinés par les fluctuations du commerce mondial, appelaient avec raison le « gran fino », le grand fin, c’est-à-dire le dessus du panier. Chose curieuse : la fondation de l’Université de São Paulo, grande œuvre dans la vie de Georges Dumas, devait permettre à ces classes modestes de commencer leur ascension en obtenant des diplômes qui leur ouvraient des positions administratives, si bien que notre mission universitaire a contribué à former une élite nouvelle, laquelle allait se détacher de nous… même si elle s’attelait à la tâche de déboulonner une féodalité qui nous avait, certes, introduits au Brésil , mais pour lui servir en partie de caution et pour l’autre de passe-temps….
Ma carrière s’est jouée un dimanche de l’automne 1934, à 9 heures du matin, sur un coup de téléphone. C’était Célestin Bouglé, alors directeur de l’Ecole normale supérieure… Il me demanda abruptement : « Avez-vous toujours le désir de faire de l’ethnographie ? – Certes ! – Alors, posez votre candidature comme professeur de sociologie à l’Université de São Paulo. Les faubourgs sont remplis d’Indiens, vous leur consacrerez vos weeks-ends… » A ce moment, l’extravagante promesse de Bouglé relative aux Indiens me posait problème. D’où avait-il tiré la croyance que São Paulo était une ville indigène, au moins par sa banlieue ? Sans doute d’une confusion avec Mexico ou Tegucigalpa. Ce philosophe qui avait jadis écrit un ouvrage sur « le Régime des castes » dans l’inde, sans se demander un seul instant s’il n’eût pas mieux valu, d’abord, y aller voir (« dans le flux des événements, ce sont les institutions qui surnagent », proclamait-il avec hauteur dans sa préface de 1927), ne pensait pas que la condition des indigènes dût avoir un sérieux retentissement sur l’enquête ethnographique…
Quoi qu’il en soit, j’étais trop ignorant moi-même pour ne pas accueillir des illusions si favorables à mon dessein, d’autant que Georges Dumas avait sur la question des notions également imprécises : il avait connu le Brésil méridional à une époque où l’extermination des populations indigènes n’était pas encore parvenue à son terme, et surtout, la société de dictateurs, de féodaux et de mécènes dans laquelle il se plaisait ne lui avait guère fourni de lumières sur ce sujet.
Je fus donc bien étonné quand, au cours d’un déjeuner où m’avait amené Victor Marguerite, j’entendis de la bouche de l’ambassadeur du Brésil à Paris le son de cloche officiel : « Des Indiens ? Hélas, mon cher Monsieur, mais voici des lustres qu’ils ont tous disparu. Oh, c’est là une page bien triste, bien honteuse, dans l’histoire de mon pays. Mais les colons portugais du XVIe siècle étaient des hommes avides et brutaux. Comment leur reprocher d’avoir participé à la rudesse générale des mœurs ? Ils se saisissaient des Indiens, les attachaient à la bouche des canons et les déchiquetaient vivants à coups de boulets. C’est ainsi qu’on les a eus, jusqu’au dernier. Vous allez, comme sociologue, découvrir au Brésil des choses passionnantes, mais les Indiens n’y songez plus, vous n’en trouverez plus un seul… »
Quand j’évoque aujourd’hui ces propos, ils me paraissent incroyables, même dans la bouche d’un « gran fino » de 1934 et me souvenant à quel point l’élite brésilienne d’alors (heureusement, elle a changé depuis) avait horreur de toute allusion aux indigènes et plus généralement aux conditions primitives de l’intérieur, sinon pour admettre – et même suggérer – qu’une arrière-grand-mère indienne était à l’origine d’une physionomie imperceptiblement exotique, et non pas de ces quelques gouttes, ou litres, de sang noir qu’il devenait déjà de bon ton d’essayer de faire oublier. Pourtant, chez Luis de Souza-Dantas, l’ascendance indienne n’était pas douteuse et il eût pu aisément s’en glorifier. Mais, Brésilien d’exportation qui avait depuis l’adolescence adopté la France, il avait perdu jusqu’à la connaissance de l’état réel de son pays, à quoi s’était substitué dans sa mémoire une sorte de poncif officiel et distingué.
Dans la mesure où certains souvenirs lui étaient restés, il préférait aussi, j’imagine, ternir les Brésiliens du XVIe siècle pour détourner l’attention du passe-temps favori qui avait été celui des hommes de la génération de ses parents et même encore du temps de sa jeunesse : à savoir, recueillir dans les hôpitaux les vêtements infectés des victimes de la variole, pour aller les accrocher avec d’autres présents le long des sentiers encore fréquentés par les tribus. Grâce à quoi fut obtenu ce brillant résultat : l’Etat de São Paulo, aussi grand que la France, que les cartes de 1918 indiquaient encore aux deux tiers « territoire inconnu habité seulement par les indiens », ne comptait, quand j’arrivai en 1935, plus un seul indigène, sinon un groupe de quelques familles localisées sur la côte qui venaient vendre le dimanche, sur les plages de Santos, de prétendues curiosités. Heureusement, à défaut des faubourgs de São Paulo, à trois mille kilomètres dans l’intérieur, les Indiens étaient encore là…
Pour mesurer le caractère absolu, total, intransigeant des dilemmes dans lesquels l’humanité du XVIe siècle se sentait enfermée, il faut se rappeler quelques incidents. Dans l’Hispaniola (aujourd’hui Haïti et Saint-Domingue) où les indigènes, au nombre de cent mille environ en 1492, n’étaient plus que deux cents un siècle après, mourant d’horreur et de dégoût pour la civilisation européenne plus encore que sous la variole et les coups, les colonisateurs envoyaient commission sur commission afin de déterminer la nature des indigènes… On n’était même pas sûr que ce fussent des hommes, et non point des créatures diaboliques ou des animaux… Et comme conclusion unanime : « Il vaut mieux pour les Indiens devenir des hommes esclaves que de rester des animaux libres… » (…)
Dans ce Rio qui m’est maintenant donné en pâture, je devais deviner l’histoire… à la faveur d’une excursion archéologique… Dans une sablière, des paysans avaient récemment mis à jour des fragments de poterie. Je palpe cette céramique épaisse, d’une facture incontestablement tupi par son engobe blanc bordé de rouge et le fin lacis de traits noirs, labyrinthe destiné, dit-on, à égarer les mauvais esprits en quête des ossements humains jadis préservés dans ces urnes…
Rio de Janeiro n’est pas construite comme une ville ordinaire. Etablie d’abord sur la zone plate et marécageuse qui borde la baie, elle s’est introduite entre les mornes abrupts qui l’enserrent de toutes parts, à la façon des doigts dans un gant trop étroit. Des tentacules urbains, longs parfois de vingt ou trente kilomètres, glissent au bas de formations granitiques dont la pente est si raide que nulle végétation ne peut s’y accrocher… Cette ville si prodigue en collines les traite avec un mépris qu’explique en partie le manque d’eau au sommet… En 1935, à Rio, la place occupée par chacun dans la hiérarchie sociale se mesurait à l’altimètre : d’autant plus basse que le domicile était haut. Les miséreux vivaient perchés sur les mornes, dans les favellas où une population de noirs, vêtus de loques bien lessivées, inventaient sur la guitare ces mélodies alertes qui, au temps du carnaval, descendraient des hauteurs et envahiraient la ville avec eux.
Dès qu’on s’engage sur une de ces pistes urbaines qui enfoncent leurs méandres entre les collines, l’aspect devient très vite faubourien. Botafogo, au bout de l’avenue Rio-Branco, c’est encore la ville de luxe, mais, après Flamengo, on se croirait à Neuilly…
Le rivage entre Rio et Santos propose encore des tropiques de rêve… Des petits ports, distants l’un de l’autre d’une centaine de kilomètres, abritent les pêcheurs dans des demeures du XVIIIe siècle, maintenant en ruine et que jadis construisirent en pierres noblement taillées des armateurs, capitaines et vice-gouverneurs. Angra-dos-Reis, Ubatuba, Parati, São Sebastão, Villa-Bella, autant de points où l’or, les diamants, les topazes et les chrysolithes extraits dans les Minas Gerais, les « mines générales » du royaume, aboutissaient après des semaines de voyage à travers la montagne, transportés à dos de mulet… Bougainville a raconté les précautions entourant l’exploitation et le transport. A peine extrait, l’or devait être remis à des Maisons des Fondations situées dans chaque district : Rio-das-Mortes, Sabara, Serro-Frio. On y percevait les droits de la couronne, et ce qui revenait aux exploitants leur était remis en barres marquées de leur poids, leur titre, leur numéro et des armes du roi…
Pour les diamants, le système était plus strict encore. Les entrepreneurs, raconte Bougainville, « sont obligés de donner un compte exact des diamants trouvés et de les remettre entre les mains de l’intendant préposé par le roi à cet effet. Cet intendant les dépose aussitôt dans une cassette cerclée de fer et fermée avec trois serrures… Le vice-roi n’a pas le pouvoir de visiter ce qu’elle renferme. Il consigne seulement le tout à un troisième coffre-fort qu’il envoie à Lisbonne, après avoir apposé son cachet sur la serrure. L’ouverture se fait en présence du roi, qui choisit les diamants qu’il veut, et en paye le prix aux entrepreneurs sur le pied d’un tarif réglé par leur traité. »
De cette intense activité qui, pour la seule année 1762, avait porté sur le transport, le contrôle, la frappe et l’expédition d cent dix-neuf arrobes d’or, c’est-à-dire plus d’une tonne et demie, rien ne subsiste au long de cette côte rendue à l’Eden, sinon quelques façades majestueuses et solitaires au fond de leur crique, murailles battues par les flots au pied desquelles abordaient les galions…
Après s’être repu d’or, le monde eut faim de sucre, mais le sucre consommait lui-même des esclaves. L’épuisement des mines – précédé d’ailleurs par la dévastation des forêts donnant le combustible aux creusets – l’abolition de l’esclavage, enfin une demande mondiale croissante orientent São Paulo et son port Santos vers le café. De jaune, puis blanc, l’or est devenu noir…
On a d’abord défriché pour cultiver ; mais au bout de quelques années, le sol épuisé et lavé par les pluies s’est dérobé aux caféiers. Et les plantations se sont transportées plus loin, là où la terre était encore vierge et fertile… Une agriculture de rapine s’est saisie d’une richesse gisante et puis s’en est allée ailleurs, après avoir arraché quelques profits… En cent ans, la flambée agricole a traversé l’Etat de São Paulo. Allumée au milieu du XIXe siècle par les mineiros délaissant leurs filons taris, elle s’est déplacée d’est en ouest et j’allais bientôt la rattraper de l’autre côté du fleuve Parana s’ouvrant un passage à travers une foule confuse de troncs abattus et de familles déracinées…
En 1935, les Paulistes se vantaient qu’on construisit dans leur ville, en moyenne, une maison par heure. Il s’agissait alors de villas ; on m’assure que le rythme est resté le même, mais pour les immeubles. La ville se développe à une telle vitesse qu’il est impossible de s’en procurer un plan : chaque semaine demanderait une nouvelle édition…
On dépeignait alors São Paulo comme une ville laide. Sans doute, les immeubles du centre étaient pompeux et démodés ; la prétentieuse indigence de leur ornementation se trouvait encore aggravée par la pauvreté du gros œuvre… Et pourtant, São Paulo n’a jamais paru laide : c’était une ville sauvage… Construite à l’origine sur une terrasse en forme d’éperon pointant vers le nord, au confluent de deux petites rivières, les rios Anhangabahu et Tamanduatehy qui se jettent un peu plus bas dans le Rio Tiete, affluent du Parana, ce fut une simple « réduction d’Indiens » : centre missionnaire autour duquel les jésuites portugais s’efforcèrent, dès le XVIe siècle, de grouper les sauvages et de les initier aux vertus de la civilisation. ...
A l’abri de cette faune pierreuse, l’élite pauliste, pareille à ses orchidées favorites, formait une flore nonchalante et plus exotique qu’elle ne croyait. Les botanistes enseignent que les espèces tropicales comprennent des variétés plus nombreuses que celles des zones tempérées bien que chacune soit, en revanche, constituée par un nombre par un nombre parfois très petit d’individus. Le « gran fino » local avait poussé à l’extrême cette spécialisation.
Une société restreinte s’était réparti les rôles. Toutes les occupations, tous les goûts, les curiosités justiciables de la civilisation contemporaine s’y rencontraient, mais chacune figurée par un seul représentant. Nos amis n’étaient pas des personnes, mais plutôt des fonctions dont l’importance intrinsèque, moins que leur disponibilité, semblait avoir déterminé la liste. Il y avait ainsi le catholique, le libéral, le légitimiste, le communiste ; ou, sur un autre plan, le gastronome, le bibliophile, l’amateur de chiens (ou de chevaux) de race, de peinture ancienne, de peinture moderne ; et aussi l’érudit local, le poète surréaliste, le musicologue, le peintre… Il faut bien reconnaître que certains rôles étaient tenus avec un brio extraordinaire, dû à la combinaison de la fortune héritée, du charme inné et de la roublardise acquise, qui rendaient si délicieuse et si décevante en même temps la fréquentation des salons…
Dans ce Brésil qui avait connu quelques éclatantes réussites individuelles, mais rares : Euclides da Cunha, Oswaldo Cruz, Chagas, Villa-Lobos, la culture était restée, jusqu’à une époque récente, un jouet pour les riches. Et c’est parce que cette oligarchie avait besoin d’une opinion publique d’inspiration civile et laïque, pour faire pièce à l’influence traditionnelle de l’Eglise et de l’armée ainsi qu’au pouvoir personnel, qu’en créant l’Université de São Paulo, elle entreprit d’ouvrir la culture à une plus large clientèle…
Au cours des XIXe et XXe siècles, l’anneau mouvant de la frange pionnière s’était lentement déplacé d’est en ouest et du sud vers le nord. En1836, seule la Norte, c’est-à-dire la région entre Rio et São Paulo était solidement occupée, et le mouvement gagnait la zone centrale de l’Etat. Vingt ans plus tard, la colonisation mordait au nord-est sur la Mogiana et la Paulista ; en 1886, elle entamait l’Araquara, l’Alta Sorocabana et la Noroeste. Dans ces dernières zones, en 1935 encore, la courbe de croissance de la population épousait celle de la production du café tandis que, dans les vieilles terres du Nord, l’effondrement de l’une anticipait d’un demi-siècle le déclin de l’autre : la chute démographique commence à s’y faire sentir à partir de 1920, alors que, dès 1854, les terres épuisées tombent à l’abandon… C’est seulement dans les grandes villes de la côte – Rio et São Paulo – que l’expansion urbaine semblait avoir une base assez solide pour paraître irréversible : São Paulo comptait 240 000 habitants en 1900, 580 000 en 1920, passait le million en 1928 et double ce cap aujourd’hui. Mais, à l’intérieur, les espèces urbaines naissaient et disparaissaient, en même temps qu’elle se peuplait, la province se dépeuplait…
Dès qu’on quittait la côte, il ne fallait pas perdre de vue que, depuis un siècle, le Brésil s’était transformé plus qu’il ne s’était développé.
A l’époque impériale, l’occupation humaine était faible, mais relativement bien répartie. Si les villes littorales ou voisines restaient petites, celles de l’intérieur avaient une vitalité plus grande qu’aujourd’hui. Par un paradoxe historique qu’on a trop souvent tendance à oublier, l’insuffisance générale des moyens de communication favorisait les plus mauvais ; quand on n’avait d’autre ressource que d’aller à cheval, on éprouvait moins de répugnance à prolonger de tels voyages pendant des mois plutôt que des jours ou des semaines, et à s’enfoncer là où le mulet seul pouvait se risquer. L’intérieur du Brésil vivait solidairement d’une vie lente sans doute, mais continue… Si l’on excepte les régions les plus reculées, l’abandon dans lequel était tombé le Brésil central au début du XXe siècle ne reflétait nullement une situation primitive : il était le prix payé pour l’intensification du peuplement et des échanges dans les régions côtières, en raison des conditions de vie modernes qui s’y instauraient ; tandis que l’intérieur, parce que le progrès y était trop difficile, régressait au lieu de suivre le mouvement au rythme ralenti qui lui appartient…
L’Etat de São Paulo évoque aussi d’autres événements : la lutte qui, dès le XVIe siècle, opposa les jésuites et les planteurs, chacun défendant une autre forme de peuplement. Avec les réductions, les premiers voulaient arracher les Indiens à la vie sauvage et les grouper sous leur direction dans un genre de vie communal… Les planteurs, fazendeiros, jalousaient le pouvoir temporel des missions qui freinait leurs exactions et les privait aussi de main d’œuvre servile. Ils lançaient des expéditions punitives à la suite desquelles prêtres et Indiens se débandaient. Ainsi s’explique ce trait singulier de la démographie brésilienne que la vie de village, héritière des aldeias, se soit maintenue dans les régions les plus pauvres, tandis qu’ailleurs, là où une terre riche était âprement convoitée, la population n’avait d’autre choix que de se grouper autour de la maison du maître, dans les cahutes de paille ou de torchis toutes semblables, où le propriétaire pouvait garder l’œil sur les colons…
Puis un jour, sur quelques milliers d’hectares reçus en concession, un « colonel » - titre libéralement distribué aux gros propriétaires et aux agents politiques – cherche à se bâtir une influence ; il recrute, il embauche, il rabat une population flottante…
En 1935, deux types de villes conservaient un aspect traditionnel tout en restant vivantes. C’étaient les pousos, villages de carrefour, et les bocas de sertão, « bouches de la brousse », à l’aboutissement des pistes. Déjà le camion commençait à se substituer aux anciens moyens de transport : caravanes de mules ou chars à bœufs, empruntant les mêmes pistes, contraint par leur état précaire à rouler en première ou en seconde sur des centaines de kilomètres, réduit au même rythme de marche que les bêtes de somme et astreint aux mêmes étapes où se cotoyaient les chauffeurs en salopettes huileuses et les tropeiros harnachés de cuir…
A l’époque de la découverte, toute la zone sud du Brésil servait d’habitat à des groupements parents par la langue et par la culture et que l’on confondait naguère sous le nom de Gé. Ils avaient été vraisemblablement refoulés par des envahisseurs récents de langue tupi qui occupaient déjà toute la bande côtière et contre lesquels ils luttaient. Protégés par leur repli dans des zones d’accès difficile, les Gé du sud du Brésil ont survécu pendant quelques siècles aux Tupi, vite liquidés par les colonisateurs. Dans les forêts des Etats méridionaux : Parana et Santa Catarina, des petites bandes sauvages se sont maintenues jusqu’au XXe siècle ; il en subsistait peut-être quelques-unes en 1935, si férocement persécutées au cours des cent dernières années qu’elles se rendaient invisibles ; mais la plupart avaient été réduites et fixées par le gouvernement brésilien, aux environs de 1914, dans plusieurs centres. Au début, on s’efforça de les intégrer à la vie moderne… Vingt ans plus tard, ces tentatives étaient abandonnées. En laissant les Indiens à leurs ressources, le Service de Protection témoignait de l’indifférence dont il était devenu l’objet de la part des pouvoirs publics…
Un des exemples de société indienne est celle des Mbaya-Guaicuru dont, avec les Toba et les Pilaga du Paraguay, les Caduveo du Brésil sont aujourd’hui les derniers représentants… Nobles hommes et nobles dames se divertissaient aux tournois ; ils étaient déchargés des travaux subalternes par une population plus anciennement installée, différente par la langue et la culture, les Guana. Les Tereno, qui sont leurs derniers représentants, vivent dans une réserve gouvernementale, non loin de la petite ville de Miranda où je suis allé les visiter. Ces Guana cultivaient la terre et payaient un tribut de produits agricoles aux seigneurs mbaya en échange de leur protection, entendez pour se préserver du pillage et des déprédations exercées par les bandes de cavaliers armés…
Les Mbaya étaient organisés en castes : au sommet de l’échelle sociale, les nobles divisés en deux ordres, grands nobles héréditaires et anoblis individuels, généralement pour sanctionner la coïncidence de leur naissance avec celle d’un enfant de haut rang. Les grands nobles se distinguaient au surplus entre branches aînées et branches cadettes. Ensuite venaient les guerriers, parmi lesquels les meilleurs étaient admis, après initiation, dans une confrérie qui donnait droit au port de noms spéciaux et à l’emploi d’une langue artificielle formée par l’adjonction d’un suffixe à chaque mot, comme dans certains argots. Les esclaves chamacoco ou d’autre extraction et les serfs guana constituaient la plèbe, bien que ces dernier aient adopté, pour leurs besoins propres, une division en trois castes imitée de leurs maîtres…
Quand Rondon annonça qu’il allait ouvrir à la civilisation la région du nord-ouest, des souvenirs se ranimèrent… Vers 1900, le plateau septentrional était resté une région mythique, où l’on affirmait même que se trouvait une chaîne de montagnes, la Sera do Norte, que la plupart des cartes continuent de mentionner.
Cette ignorance, combinée avec les récits de la pénétration, récente encore, du Far West américain et de la ruée vers l’or, inspira de folles espérances à la population du Mato Grosso et même à celle de la côte. A la suite des hommes de Rondon posant leur fil télégraphique, un flot d’émigrants allait envahir des territoires aux ressources insoupçonnées, y bâtir quelque Chicago brésilienne. Il fallut déchanter : à l’image du nord-est où sont les terres maudites du Brésil dépeintes par Euclides da Cunha dans « Os Sertões », la Sera do Norte allait se révéler savane semi désertique et l’une des zones les plus ingrates du continent…
En 1931, le poste télégraphique de Paressi, situé dans une région relativement fréquentée à trois cents kilomètres au nord de Cuiba et à quatre-vingts kilomètres de Diamantino seulement avait été attaqué et détruit par des Indiens inconnus, sortis de la vallée du Rio do Sangue qu’on croyait inhabitée. Ces sauvages avaient été baptisés beiços de pau, museau de bois, en raison des disques qu’ils portaient enchâssés dans la lèvre inférieure et les lobes des oreilles. Depuis lors, leurs sorties s’étaient répétées à intervalles irréguliers, de sorte qu’il avait fallu déplacer la piste d’environ quatre-vingts kilomètres vers le sud. Quant aux Nambikwara, nomades qui fréquentaient par intermittence les postes depuis 1909, leurs relations avec les blancs avaient été marquées par des fortunes diverses. Assez bonnes au début, elles empirèrent progressivement jusqu’en 1925, date à laquelle sept travailleurs furent conviés par les indigènes à visiter leurs villages où ils disparurent. A partir de ce moment, Nambikwara et les gens de la ligne s’évitèrent. En 1933, une mission protestante vint s’installer non loin du poste de Juruena ; il semble que les rapports s’aigrirent vite, les indigènes ayant été mécontents des présents – insuffisants dit-on – par lesquels les missionnaires reconnurent leur aide pour la construction de la maison et la plantation du jardin. Quelques mois plus tard, un Indien fiévreux se présenta à la mission et reçut publiquement deux comprimés d’aspirine qu’il absorba après quoi il s’en alla prendre un bain de rivière, eut une congestion et mourut. Comme les Nambikwara sont des empoisonneurs experts, ils conclurent que leur compagnon avait été assassiné : une attaque de représailles eut lieu, au cours de laquelle les six membres de la mission furent massacrés….
Comment l’incident responsable du massacre avait-il pu se produire ? Je m’en rendis compte moi-même à l’occasion d’une maladresse qui faillit me coûter cher. Les Nambikwara ont des connaissances toxicologiques. Ils fabriquent du curare pour leurs flèches à partir d’une infusion de la pellicule rouge revêtant la racine de certains strychos, qu’ils font évaporer au feu jusqu’à ce que le mélange ait acquis une consistance pâteuse et ils emploient d’autres poisons végétaux que chacun transporte avec soi sous forme de poudres enfermées dans des tubes de plume ou de bambou, entourés de fils de coton ou d’écorce.
Ces poisons servent aux vengeances commerciales ou amoureuses…
Outre ces poisons de caractère scientifique, que les indigènes préparent ouvertement sans aucune de ces précautions et complications magiques qui accompagnent, plus au nord, la fabrication du curare, les Nambikwara en ont d’autres dont la nature est mystérieuse. Dans des tubes identiques à ceux contenant les poisons vrais, ils recueillent des particules de résine exsudée par une arbre du genre bombax, au tronc renflé dans sa partie moyenne ; ils croient qu’en projetant une particule sur un adversaire, ils provoqueront une condition physique semblable à celle de l’arbre : la victime enflera et mourra…
Ces explications étaient nécessaires pour comprendre ce qui suit. J’avais emporté dans mes bagages quelques-uns de ces grands ballons multicolores en papier de soie qu’on emplit d’air chaud en suspendant à leur base une petite torche, et qu’on lance par centaines, au Brésil, à l’occasion de la fête de la Saint-Jean ; l’idée malencontreuse me vint un soir d’en offrir le spectacle aux indigènes… Mais la gaieté du début avait fait place à d’autres sentiments, les hommes regardaient avec attention et hostilité, et les femmes, tête enfouie entre les bras et blotties l’une contre l’autre, étaient terrifiées…
Pourtant, cet incident et d’autres que je conterai par la suite, n’ont rien enlevé à l’amitié que seule pouvait inspirer une intimité prolongée avec les Nambikwara. Aussi ai-je été bouleversé en lisant récemment, dans une publication d’un collègue étranger, la relation de sa rencontre avec la même bande indigène dont, dix ans avant qu’il ne la visitât, j’avais partagé l’existence à Utiarity...
Notre auteur s’exprime comme suit :
« De tous les Indiens que j’ai vus au Mato Grosso, cette bande rassemblait les plus misérables… Les Nambikwara sont hargeux et impolis jusqu’à la grossiereté. Quand je rendais visite à Julio à son campement, il arrivait souvent que je le trouve couché près du feu ; mais en me voyant approcher il me tournait le dos en déclarant qu’il ne désirait pas me parler. Les missionnaires m’ont raconté qu’un Nambikwara demandera plusieurs fois qu’on lui donne un objet, mais qu’en cas de refus, il essayera de s’en emparer… Il n’est pas nécessaire de rester longtemps chez les Nambikwara pour prendre conscience de leurs sentiments profonds de haine, de méfiance et de désespoir qui suscitent chez l’observateur un état de dépression dont la sympathie n’est pas complètement exclue. » (extrait de K. Oberg, « Indian Tribes of Northern Mato Grosso, Brazil »)
Pour moi, qui les ai connus à une époque où les maladies introduites par l’homme blanc les avaient déjà décimés, mais où – depuis les tentative toujours humaines de Rondon – nul n’avait entrepris de les soumettre, je voudrais oublier cette description navrante et ne rien conserver dans la mémoire, que ce tableau repris de mes carnets de notes où je griffonnai une nuit à la lueur de ma lampe de poche :
« (…) On devine chez tous une immense gentillesse, une profonde insouciance, une naïve et charmante satisfaction animale, et, rassemblant ces sentiments divers, quelque chose comme l’expression la plus émouvante et la plus véridique de la tendresse humaine. » (…)
Si peu connus que fussent les Indiens du Pimenta-Bueno, je ne pouvais attendre d’eux le choc ressenti par les grands auteurs : Léry, Staden, Thevet, qui, il y a quatre cents ans, mirent le pied sur le territoire brésilien. Ce qu’ils virent alors, nos yeux ne l’apercevront jamais plus. Les civilisations qu’ils furent les premiers à considérer s’étaient développées selon d’autres lignes que les nôtres, elles n’en avaient pas moins atteint toute la plénitude et toute la perfection compatibles avec leur nature, tandis que les sociétés que nous pouvons étudier aujourd’hui – dans des conditions qu’il serait illusoire de comparer à celles prévalant il y a quatre siècles – ne sont plus que des corps débiles et des formes mutilées. Malgré d’énormes distances et toutes sortes d’intermédiaires (d’une bizarrerie souvent déconcertante quand on parvient à en reconnaître la chaîne), elles ont été foudroyées par ce monstrueux et incompréhensible cataclysme que fut, pour une si large et si innocente fraction de l’humanité, le développement de la civilisation occidentale ; celle-ci aurait bien tort d’oublier qu’il lui fait un second visage, pas moins véridique et indélébile que l’autre… Si l’Occident a produit des ethnographes, c’est qu’un bien puissant remords devait le tourmenter, l’obligeant à confronter son image à celle de sociétés différentes dans l’espoir qu’elles réfléchiront les mêmes tares ou l’aideront à expliquer comment les siennes se sont développées dans son sein…
L’étude de ces sauvages apporte autre chose que la révélation d’un état de nature utopique, ou la découverte de la société parfaite au cœur des forêts, elle nous aide à bâtir un modèle théorique de la société humaine, qui ne correspond à aucune réalité observable, mais à l’aide duquel nous parviendrons à démêler ce qu’il y a d’originaire et d’artificiel dans la nature actuelle de l’homme et à bien connaître un état qui n’existe plus, qui peut-être n’a point existé, qui probablement n’existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d’avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent…
Puisque être homme signifie, pour chacun de nous, appartenir à une classe, à une société, à un pays, à un continent et à une civilisation ; et que pour nous, Européens et terriens, l’aventure au cœur du Nouveau Monde signifie d’abord qu’il ne fut pas le nôtre, et que nous portons le crime de sa destruction ; et ensuite, qu’il n’y en aura pas d’autres : ramenés à nous-mêmes par cette confrontation, sachons au moins l’exprimer dans ses termes premiers – en premier lieu, et nous rapportant à un temps où notre monde a perdu la chance qui lui était offerte de choisir entre ses missions. »
Extraits de « Tristes tropiques » (1955) de Claude Lévi-Strauss
Lire aussi :
« Le Brésil et la colonisation », par Elisée Reclus
« Le Brésil et la colonisation », deuxième partie, par Elisée Reclus
« Voyages dans l’intérieur du Brésil », par M. de Saint-Hilaire
« Histoire d’un voyage fait en terre du Brésil » par Jean de Léry
« L’empire du Brésil et la société brésilienne en 1850 », par Emile Adet
« Le Brésil en 1844 », deuxième partie
« Le Brésil sous l’empereur Dom Pedro II
« Le Brésil et la Société brésilienne », première partie
« Le Brésil et la Société brésilienne », deuxième partie
« Le Brésil et la Société brésilienne », troisième partie
« Les voyages d’exploration d’un docteur allemand dans le Brésil central »
« Bella-Union – Destruction récente des Indiens Guaranis »
Les peuples indigènes du Brésil
Les Indiens menacés de mort dans le Brésil actuel
Un rapport sur le génocide des Indiens du Brésil sort de l’ombre
